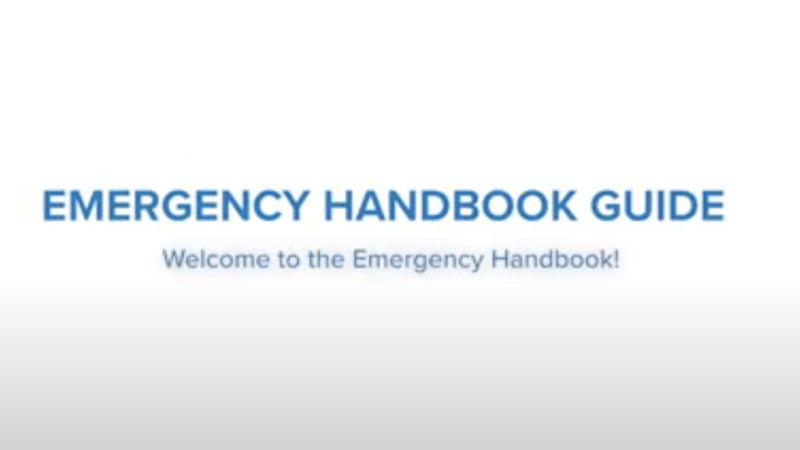Important: les liens vers les sites Web externes, les vidéos et les contenus intégrés ne fonctionneront pas hors connexion.
Pour accéder à l’application hors ligne du Manuel pour les situations d’urgence, veuillez sélectionner le format souhaité ci-dessous.
Veuillez vous connecter à l’aide de vos identifiants HCR pour accéder à l’ensemble du contenu de l’application hors ligne du Manuel pour les situations d’urgence.
Important: les liens vers les sites Web externes, les vidéos et les contenus intégrés ne fonctionneront pas hors connexion.
Vidéo du manuel
Guide de l’utilisateur du manuel
Aidez-nous à améliorer l’expérience utilisateur de notre site en nous faisant part de votre opinion…
Nous nous engageons à fournir des traductions dans plusieurs langues. Bien que certains contenus ne soient pas disponibles dans votre langue préférée, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour voir la liste complète des traductions accessibles.
Latest updates
Les équipes opérationnelles de pays du HCR doivent se préparer aux situations d’urgence : suivi des risques, mise en œuvre de mesures de préparation et planification des interventions d’urgenc
L’intervention d’urgence du HCR vise en premier lieu à protéger et autonomiser les personnes contraintes de fuir leur foyer, en particulier les plus vulnérables.
Pour sauver des vies dans les situations d’urgence, il convient de répondre de manière responsable et participative aux besoins fondamentaux des personnes contraintes de fuir leur foyer.
Pour être efficace, une intervention d’urgence a besoin d’un encadrement stratégique, d’une coordination rationalisée, d’un partage d’informations et d’une approche inclusive du partenariat.
Il est impossible de mener une intervention d’urgence sans une équipe opérationnelle du HCR solide et efficace.
Le déploiement rapide du personnel d’urgence constitue une priorité dès le début d’une situation d’urgence et requiert une gestion sans faille des ressources humaines.